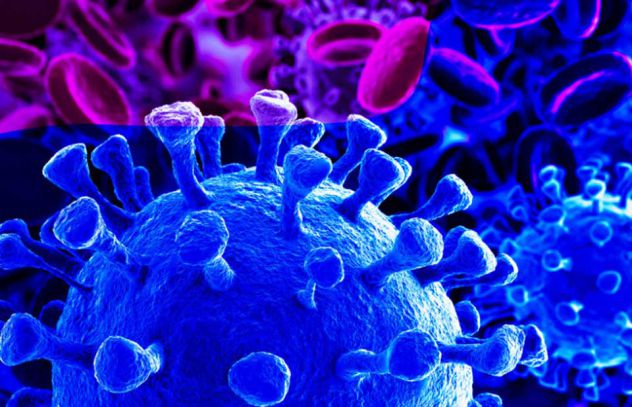 LŌĆÖ├®pid├®mie li├®e ├Ā la Covid-19 a boulevers├® lŌĆÖensemble des secteurs dŌĆÖactivit├® et le Gouvernement a d├®cr├®t├® lŌĆÖ├®tat dŌĆÖurgence sanitaire prolong├® jusquŌĆÖau 10 juillet.
LŌĆÖ├®pid├®mie li├®e ├Ā la Covid-19 a boulevers├® lŌĆÖensemble des secteurs dŌĆÖactivit├® et le Gouvernement a d├®cr├®t├® lŌĆÖ├®tat dŌĆÖurgence sanitaire prolong├® jusquŌĆÖau 10 juillet.
Les Hauts-de-France particuli├©rement touch├®s
Les Hauts-de-France figurent parmi les r├®gions les plus touch├®es, m├¬me si des disparit├®s d├®partementales existent.
Hormis lŌĆÖinformation r├®cente o├╣ un patient fran├¦ais aurait ├®t├® d├®couvert positif d├©s la fin d├®cembre en Seine-Saint-Denis, le patient 0 serait hauts-fran├¦ais et plus pr├®cis├®ment du sud du d├®partement de l'Oise. Ainsi un des premiers clusters au niveau national a pu ├¬tre rep├®r├® ├Ā Cr├®py-en-Valois/Creil et, au 5 mars 2020, il ├®tait le plus important des six clusters identifi├®s, avec 99 cas confirm├®s.

Entre lŌĆÖapparition de lŌĆÖ├®pid├®mie et jusque au d├®but du mois d'avril le nombre de personnes hospitalis├®es pour Covid-19 nŌĆÖa cess├® de cro├«tre. En France, il est
pass├® de presque 3 000 le 18 mars ├Ā pr├®s de 21 400 le 11 mai, jour de d├®confinement, apr├©s sŌĆÖ├¬tre ├®lev├® ├Ā 31 000 le 14 avril. La r├®gion Hauts-de-France a connu la m├¬me ├®volution passant de 311 hospitalisations ├Ā quelque 2 500 le 14 avril, pour redescendre ├Ā 1 900. En r├®gion, le maximum dŌĆÖhospitalisations se situe entre les 14 et 21 avril, soit quelques jours apr├©s le niveau national (12-15 avril). Depuis le 21 avril, la d├®croissance est continue : le 11 mai, il y avait d├®j├Ā moins de personnes hospitalis├®es que le 3 avril, soit 1 914.
En ce qui concerne les hospitalisations, le ratio hommes-femmes montre que depuis le d├®but de lŌĆÖ├®pid├®mie, il y a toujours eu plus dŌĆÖhommes hospitalis├®s que de femmes : le 17 mars, on enregistrait 1,2 homme pour une femme. Ce ratio nŌĆÖa cess├® de d├®cro├«tre jusquŌĆÖau 30 mars o├╣ il sŌĆÖ├®tablissait ├Ā 104 hommes pour 100 femmes. Depuis, le ratio a contin├╗ment baiss├®. Il a ├®t├® quasiment ├®quivalent ├Ā 1 entre le 17 et le 20 avril, pour sŌĆÖinverser depuis.
Les diff├®rences entre les d├®partements sont importantes. En nombre absolu, le d├®partement du Nord a re├¦u le plus de personnes en hospitalisation et lŌĆÖAisne le moins. Rapport├®s aux populations d├®partementales, les taux dŌĆÖhospitalisation montrent une r├®alit├® assez diff├®rente, avec des taux plus ├®lev├®s dans le sud de r├®gion. Ainsi, le 11 mai, le taux dŌĆÖhospitalisation est de 121 pour 100 000 habitants dans les Hauts-de-France, allant de 116 (Nord) ├Ā 251 (Aisne).
En fonction du genre, les donn├®es dŌĆÖhospitalisation du Pas-de-Calais varient. Pour les femmes, elles sont proches de celles des trois d├®partements du sud de la r├®gion, alors quŌĆÖelles sŌĆÖen ├®loignent pour les hommes entre la fin mars et la mi-avril pour sŌĆÖen rapprocher depuis.


En savoir +
G├®odes (Sant├® publique France)
ARS HdF : point de situation dans les Hauts-de-France
ARS HdF : un guide de gestion pour les Ehpad
Aussi sur PF2S
Covid-19 : dispositif de surveillance
Covid-19 : les sites de r├®f├®rence
 Apr├©s la perte de son statut de capitale r├®gionale, Amiens a contribu├® ├Ā la construction dŌĆÖun nouveau territoire : le p├┤le m├®tropolitain du Grand ami├®nois. Fort de huit communaut├®s dŌĆÖagglom├®ration ou de communes et de pr├©s de 400 000 habitants, soit les deux tiers du d├®partement de la Somme, il a comme comp├®tences le sch├®ma de coh├®rence territoriale (Scot), le plan climat air ├®nergie territorial (PCAET) et le conseil de d├®veloppement en commun, instance de d├®mocratie participative.
Apr├©s la perte de son statut de capitale r├®gionale, Amiens a contribu├® ├Ā la construction dŌĆÖun nouveau territoire : le p├┤le m├®tropolitain du Grand ami├®nois. Fort de huit communaut├®s dŌĆÖagglom├®ration ou de communes et de pr├©s de 400 000 habitants, soit les deux tiers du d├®partement de la Somme, il a comme comp├®tences le sch├®ma de coh├®rence territoriale (Scot), le plan climat air ├®nergie territorial (PCAET) et le conseil de d├®veloppement en commun, instance de d├®mocratie participative.
La sant├® : une action
Parmi les cinq actions inscrites ├Ā son programme, celle de la sant├® a une place importante. Pilot├®e par un vice-pr├®sident du p├┤le, elle sŌĆÖest donn├®e pour missions le pilotage de la r├®flexion sur lŌĆÖam├®nagement du territoire avec lŌĆÖimplantation de maisons de sant├® pour lutter contre la d├®sertification m├®dicale et la repr├®sentation du territoire du Grand Ami├®nois dans les ├®changes avec lŌĆÖagence r├®gionale de sant├®.
Le Conseil de d├®veloppement en commun pour la sant├®
De son c├┤t├®, le conseil de d├®veloppement en commun rassemble quelque quatre-vingt-dix membres, issus pour partie des huit EPCI et pour partie des grands acteurs du territoire. Il sŌĆÖest constitu├® en ateliers de travail dont lŌĆÖun porte sur la sant├®.
├Ć lŌĆÖordre du jour de la commission du p├┤le comme de lŌĆÖatelier du conseil de d├®veloppement, une r├®flexion sur la d├®mographie des professions de sant├® et la compr├®hension du non-acc├©s ou du non-recours aux soins.
Pouvant travailler en auto-saisine, le conseil de d├®veloppement en commun sŌĆÖint├®resse au d├®veloppement des projets alimentaire territorial (PAT) ou encore ├Ā la compr├®hension de la situation sanitaire due ├Ā lŌĆÖ├®pid├®mie de Covid-19 dans le territoire du p├┤le m├®tropolitain.
En savoir +
 La lutte contre la pauvret├®, la garantie de la sant├® et de lŌĆÖ├®ducation sont parmi les enjeux du PACTE Sambre-Avesnois-Thi├®rache.
La lutte contre la pauvret├®, la garantie de la sant├® et de lŌĆÖ├®ducation sont parmi les enjeux du PACTE Sambre-Avesnois-Thi├®rache.
Sign├® en 2018 entre lŌĆÖ├ētat et les collectivit├®s locales, le PACTE de d├®veloppement du territoire de Sambre-Avesnois-Thi├®rache a engag├® nombre dŌĆÖactions sur le terrain. Le plan de lutte contre la pauvret├® donne ainsi corps au PACTE de d├®veloppement du territoire de Sambre-Avesnois-Thi├®rache.
Une densification de l'offre de soins
LŌĆÖagence r├®gionale de sant├® ainsi que la R├®gion portent lŌĆÖessentiel des actions de sant├®. Six nouvelles maisons de sant├® pluriprofessionnelles (MSP) sont venues en 2019 sŌĆÖajouter aux douze d├®j├Ā existantes tandis que deux communaut├®s territoriales de sant├® sont en projet. Pour faciliter lŌĆÖinstallation des m├®decins et infirmiers, un guichet unique a ├®t├® ouvert dans le Nord en mars, ├Ā lŌĆÖinstar de celui ouvert dans lŌĆÖAisne d├©s 2016. Sept nouveaux praticiens territoriaux de m├®decine g├®n├®rale se sont install├®s dans le territoire.
En ce qui concerne lŌĆÖoffre de soins hospitali├©re, Maubeuge accueillera en 2021 un nouvel h├┤pital de 242 lits.

T├®l├®medecine
La t├®l├®m├®decine a ├®t├® d├®velopp├®e dans cinq MSP du territoires autour de la dermatologie et les plaies complexes au domicile ainsi que dans les Ehpad pour 2020. LŌĆÖespace de ressources cancers de Maubeuge et le programme dŌĆÖactions annuel de lŌĆÖespace vie cancers de Fourmies ont ├®t├® financ├®s par la R├®gion.
Pour les publics les plus d├®munis, lŌĆÖatelier sant├® ville de Fourmies et quatre adultes relais m├®diateurs sant├® ont ├®t├® mis en place et dix-huit lits m├®dicalis├®s ont ├®t├® ouverts pour les personnes sans domicile fixe. LŌĆÖaccompagnement vers le d├®pistage organis├® des cancers du sein, du c├┤lon et du col de lŌĆÖut├®rus a aussi ├®t├® organis├® en leur faveur.
Le conseil de sant├® mentale de lŌĆÖagglom├®ration de Maubeuge et les contrats locaux de sant├® du Sud Avesnois et de Maubeuge Val-de-Sambre ont ├®t├® accompagn├®s.
Pr├®vention : modifier les comportements
Concernant la pr├®vention et la promotion de la sant├®, les actions pour promouvoir les comportements favorables ├Ā la sant├® ont concern├® le d├®pistage des troubles visuels et de langage ainsi que la r├®duction du tabagisme chez les enfants et les jeunes. Elles se sont aussi focalis├®es sur lŌĆÖactivit├® physique et lŌĆÖalimentation par lŌĆÖaccompagnement par la Draaf de deux projets alimentaires territoriaux et des projets dans les ├®tablissements scolaires.
Pour les adultes, des programmes dŌĆÖarr├¬t de la consommation de tabac et de sevrage ont plus particuli├©rement ├®t├® destin├®s aux femmes enceinte et aux personnes en situation de handicap.
En savoir +
SAT : ARS, des engagements et des faits marquants
Aussi sur PF2S
Les territoires d├®monstrateurs en Hauts-de-France
Pauvret├® et emploi : une convention entre l'├ētat et le d├®partement du Nord
 La sant├® est une des premi├©res pr├®occupations des habitants ; cŌĆÖest pourquoi la R├®gion Hauts-de-France a d├®cid├® en 2020 de r├®affirmer son engagement en prenant sa place aux c├┤t├®s des partenaires r├®gionaux de la sant├® pour am├®liorer la qualit├® de vie de ses habitants.
La sant├® est une des premi├©res pr├®occupations des habitants ; cŌĆÖest pourquoi la R├®gion Hauts-de-France a d├®cid├® en 2020 de r├®affirmer son engagement en prenant sa place aux c├┤t├®s des partenaires r├®gionaux de la sant├® pour am├®liorer la qualit├® de vie de ses habitants.
Un contexte sanitaire et social de la R├®gion Hauts-de-France qui interpelle
┬½ Les plus faibles esp├®rances de vie des hommes et des femmes, en constituent lŌĆÖillustration la plus manifeste. Le retard avec le niveau national est toujours le m├¬me ; il a m├¬me tendance ├Ā sŌĆÖaggraver. Ainsi, la mortalit├® en Hauts-de-France au cours de la p├®riode 2013 ŌĆō 2015 correspond aux chiffres nationaux 10 ans plus t├┤t... ├Ć ces mauvais chiffres sŌĆÖajoutent des densit├®s de professionnels de sant├® souvent inf├®rieures ├Ā celles relev├®es dans lŌĆÖensemble du pays et une population de praticiens vieillissante. ┬╗
Les causes multifactorielles de lŌĆÖ├®tat sanitaire du territoire (environnementales, sociales, ├®conomiques voire comportementales), appellent ├Ā agir simultan├®ment sur diff├®rents leviers en vue dŌĆÖam├®liorer la qualit├® de vie de la population et son ├®tat de sant├®. ├Ć cet ├®gard, une approche coordonn├®e des diff├®rents acteurs (institutionnels, professionnels, usagers...) sera d├®terminante.
CŌĆÖest dans cette dynamique que la R├®gion inscrit lŌĆÖharmonisation de son cadre de sant├® 2020-2021 autour de cinq grands axes.
Conforter lŌĆÖ├®valuation et lŌĆÖobservation...
...est un atout majeur pour accompagner la mise en ┼ōuvre de politiques publiques. CŌĆÖest pourquoi, la R├®gion souhaite structurer, coordonner et optimiser les fonctions dŌĆÖobservation, de veille, dŌĆÖanalyse et dŌĆÖ├®valuation en d├®veloppant les outils dŌĆÖappui et dŌĆÖaccompagnement ├Ā la connaissance en mati├©re de sant├® dans toutes ses dimensions (observatoire de la Biodiversit├®, Atmo, Insee...), et au plan r├®gional et infra-r├®gional dans le domaine sanitaire et social (observatoire r├®gional de la sant├® et du social (OR2S) et plateforme sanitaire et sociale).
Mettre lŌĆÖaccent sur la pr├®vention...
... est un enjeu majeur pour favoriser la prise de conscience et lŌĆÖimplication individuelle des comportements propices ├Ā la sant├® et faire de la population des Hauts-de-France les acteurs de leur sant├®. La R├®gion souhaite pouvoir agir sur les principales causes de surmortalit├® et de d├®c├©s pr├®matur├®s que sont les cancers, les maladies cardio-vasculaires (diab├©te ŌĆō ob├®sit├®) et certaines conduites addictives. Elle entend ├®galement agir sur dŌĆÖautres d├®terminants tels que la sant├® travail, la sant├® environnement et accompagner lŌĆÖinnovation num├®rique en sant├®. ├Ć cet effet, la R├®gion a lanc├® un appel ├Ā projet en 2020 pour encourager les actions de pr├®vention et de soutien ├Ā lŌĆÖinnovation.
La R├®gion poursuit son implication dans lŌĆÖaccompagnement des personnes atteintes de cancers et de leurs familles gr├óce ├Ā la r├®gionalisation des Espaces Ressource Cancer aux c├┤t├®s de lŌĆÖARS.
Enfin, la R├®gion poursuit son inscription dans la lutte contre la progression du VIH Sida et met en place un plan de soutien en lien avec les acteurs du territoire.
R├®duire les in├®galit├®s dŌĆÖacc├©s ├Ā lŌĆÖoffre de soins...
... est une question cruciale notamment dans certains territoires marqu├®s par une d├®mographie m├®dicale d├®j├Ā lacunaire ou en voie de d├®gradation. Pour conforter la d├®mographie m├®dicale, garantir un maillage territorial suffisant et faciliter lŌĆÖacc├©s ├Ā lŌĆÖexpertise m├®dicale, la R├®gion porte une politique dŌĆÖ├®quipement ├Ā destination des professionnels de sant├® et favorise leur ancrage d├©s leur formation sur lŌĆÖensemble du territoire r├®gional (soutien aux postes dŌĆÖassistants partag├®s dans les h├┤pitaux ├®loign├®s des centres hospitaliers de Lille et Amiens, des chefs de clinique en r├®gion, fid├®lisation des jeunes professionnels param├®dicaux...). Facteur dŌĆÖ├®quit├®, le num├®rique sera ├®galement une des cl├®s ├Ā actionner pour faciliter lŌĆÖacc├©s ├Ā lŌĆÖoffre de soins pour tous.
Accompagner lŌĆÖinnovation et la recherche...
... est un atout ind├®niable pour am├®liorer la prise en charge toujours plus qualitative de la population, quŌĆÖelle soit th├®rapeutique, technologique et num├®rique ou encore organisationnelle et environnementale. Une politique dŌĆÖinvestissement associ├®e ├Ā un accompagnement de la recherche clinique compl├©tera les dispositifs de droit commun d├®j├Ā engag├®s en mati├©re de soutien ├Ā la recherche innovation.
Agir ├Ā lŌĆÖ├®chelle de la r├®gion et pr├®voir un soutien renforc├® pour les territoires prioritaires...
... pr├®sentant une situation encore plus pr├®occupante : le bassin minier, le territoire Sambre-Avesnois-Thi├®rache, les 7 vall├®es, lŌĆÖEst de la Somme...
Parmi ces territoires, figurent ceux pour lesquels la R├®gion sŌĆÖest formellement engag├®e via une contractualisation multi-partenariale (PACTE Sambre-Avesnois-Thi├®rache ; Engagement pour le renouveau du Bassin Minier). DŌĆÖautres territoires connaissent des difficult├®s de m├¬me nature comme le littoral, lŌĆÖEst de la Somme et le Nord de lŌĆÖOise. Pour tous ces territoires, une approche globale sera recherch├®e en vue de r├®duire les ├®carts par rapport ├Ā la moyenne r├®gionale. ├Ć ce titre, des interventions sp├®cifiques pourront ├¬tre envisag├®es pour r├®pondre ├Ā des situations particuli├©res, y compris dans le cadre dŌĆÖexp├®rimentations.
 Report├®e en janvier 2020 suite aux mouvements sociaux de d├®cembre, la Journ├®e de la Plateforme sur la participation citoyenne a tenu toutes ses promesses.
Report├®e en janvier 2020 suite aux mouvements sociaux de d├®cembre, la Journ├®e de la Plateforme sur la participation citoyenne a tenu toutes ses promesses.
Accueillis dans les locaux de lŌĆÖuniversit├® dŌĆÖArtois ├Ā Arras, une centaine de participants a assist├® aux pr├®sentations et d├®bats autour de la participation citoyenne ├Ā la construction de politiques publiques.
La participation comme l├®gitimation de la d├®mocratie ├®lective
En introduction, Myriam Bachir (universit├® dŌĆÖAmiens) rappelle quŌĆÖimpliquer davantage les usagers dans le processus d├®cisionnel est une question qui surgit
Co-├®laborer les projets avec ceux ├Ā qui ils s'adressent
Une telle exp├®rience de co-construction est men├®e par lŌĆÖinstitut catholique de Lille sur la recherche inclusive. Had├®pas permet ainsi ├Ā des personnes en situation de handicap de montrer que leur expertise dŌĆÖusage est une forme de savoir dont pourrait b├®n├®ficier les politiques publiques. Le croisement entre cette expertise celle des universitaires a permis la co-constrution et la co-animation dŌĆÖun module de formation sur le handicap pour des ├®tudiants de licence.
Les premi├©re et troisi├©me tables rondes de la journ├®e abordaient de mani├©res compl├®mentaires des exemples de participation citoyenne ├Ā la construction de projet impactant leur environnement proche : projet UTPAS ├Ā Bailleul-Merville, mobilit├® dans les territoires ruraux ou observation sociale par le d├®partement du Nord, d├®marche Living Lab avec lŌĆÖinstitut catholique de Lille, transport en bus dans la communaut├® urbaine de Dunkerque ou le d├®ploiement dŌĆÖAmiens for Youth ├Ā Amiens. LŌĆÖhypoth├©se sur laquelle se basent ces exp├®riences est que les citoyens savent trouver outils et ressources pour apporter de la valeur ajout├®e ├Ā de nouveaux produits, ├Ā de nouveaux services, ├Ā de nouvelles organisations. CŌĆÖest aussi, quŌĆÖau del├Ā des aspects r├®glementaires comme les enqu├¬tes dŌĆÖutilit├® publique, aller chercher la parole des citoyens dans leur lieu de vie permet de co-├®laborer avec eux des r├®ponses adapt├®es ├Ā chaque situation locale.
Les usagers acteurs actifs du recueil des donn├®es
En conclusion, Rodolphe Dumoulin, commissaire ├Ā la lutte contre la pauvret├®, sŌĆÖest montr├® int├®ress├® par ces exp├®riences de co-construction qui rejoignent les ateliers citoyens mis en ┼ōuvre par la refonte du Conseil national de lutte contre les exclusions.

27-05-2025 | Actualit├®s
En partenariat avec la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France, le groupe de travail sant├® & social de G├®o2France vous invite...
Lire la suite05-11-2024 | Social
EUROPE Le fonds social europ├®en Cr├®e en 1957, le fonds social europ├®en avait pour but initial dŌĆÖaider ├Ā la...
Lire la suite05-11-2024 | Sant├®
NATIONAL Faire Alliance pour am├®liorer la sant├® des plus jeunes Dans le cadre de lŌĆÖexp├®rimentation Faire Alliance pour am├®liorer...
Lire la suite05-11-2024 | Sant├®
FOCUS Promouvoir l'activit├® physique et sportive Corpulence, activit├® physique et s├®dentarit├® en Hauts-de-France : les enseignements des Barom├©tres Sant├® Les...
Lire la suite05-11-2024 | Sant├®
FOCUS Promouvoir l'activit├® physique et sportive Journ├®e de la Plateforme ┬½ Sport et sant├® : promouvoir l'activit├® physique pour tous...
Lire la suite
Plateforme sanitaire et sociale | Derni├©res publications
Num├®ro 26 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France octobre 2025 Au sommaire de ce num├®ro R├ēGION 2 Webinaire sur la fragilit├®...
Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Derni├©res publications
Num├®ro 25 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France ao├╗t 2025 Au sommaire de ce num├®ro R├ēGION 2 Au travail en bonne...
Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Derni├©res publications
La synth├©se de la journ├®e annuelle de la PF2S 2024 Sport & sant├® Promouvoir l'activit├® physique pour tous et...
Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Derni├©res publications
Num├®ro 24 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France d'octobre 2024 Au sommaire de ce num├®ro R├ēGION 2 Cartographie des services num├®riques r├®gionaux...
Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Derni├©res publications
Num├®ro 23 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France de juillet 2024 Au sommaire de ce num├®ro R├ēGION 2 Forte progression de la...
Lire la suite





















