FOCUS
Le sida - VIH
Une R├®gion engag├®e
 Labellis├®e dans la lutte contre le sida au niveau national depuis le 12 septembre 2019 (signature de la D├®claration de Paris), la R├®gion Hauts-de-France sŌĆÖest engag├®e aux c├┤t├®s des acteurs institutionnels et associatifs dans la lutte contre le VIH-sida. En effet, si la proportion de s├®rologies positives en Hauts-de-France est l├®g├©rement inf├®rieure ├Ā la moyenne nationale, en revanche, on constate un recours plus tardif au d├®pistage en r├®gion.
Labellis├®e dans la lutte contre le sida au niveau national depuis le 12 septembre 2019 (signature de la D├®claration de Paris), la R├®gion Hauts-de-France sŌĆÖest engag├®e aux c├┤t├®s des acteurs institutionnels et associatifs dans la lutte contre le VIH-sida. En effet, si la proportion de s├®rologies positives en Hauts-de-France est l├®g├©rement inf├®rieure ├Ā la moyenne nationale, en revanche, on constate un recours plus tardif au d├®pistage en r├®gion.
Ce constat justifie le soutien de la R├®gion en faveur dŌĆÖun plan dŌĆÖactions de pr├®vention et dŌĆÖincitation au d├®pistage, notamment aupr├©s des jeunes (lyc├®ens, apprentis, ├®tudiants), d├®fini en concertation avec de nombreux acteurs de sant├® : Agence R├®gionale de Sant├®, D├®partements, Acad├®mies, COREVIH HDF, professionnels de sant├®, associations, intitul├® ┬½ vers une r├®gion Hauts-de-France sans nouvelles contaminations par le VIH-sida et les IST ┬╗.
Ce plan sŌĆÖest traduit par le financement de dotations destin├®es aux lyc├®es et aux Services Universitaires de M├®decine Pr├®ventive et de Promotion de la Sant├® (SUMMPS) et dŌĆÖactions de pr├®vention et dŌĆÖincitation au d├®pistage men├®es ├Ā lŌĆÖ├®chelle r├®gionale. En 2021, 243 lyc├®es ont ainsi b├®n├®fici├® de 216 distributeurs, 250 000 pr├®servatifs masculins et f├®minins, 145 mallettes dŌĆÖanimation ├Ā la sant├® sexuelle. 4 SUMPPS ont b├®n├®fici├® de 1 000 autotests VIH.
Ces dotations sŌĆÖinscrivent dans le cadre dŌĆÖune convention entre la R├®gion, les Acad├®mies et les SUMPPS au terme de laquelle ces derniers se sont engag├®s ├Ā se mobiliser sur le sujet de la sant├® sexuelle, ├Ā informer, accompagner et orienter les lyc├®ens et les ├®tudiants.
La R├®gion a ├®galement soutenu la campagne de communication et de d├®pistage ┬½ Moi(s) sans tabou, les quinzaines de la sant├® sexuelle ┬╗, port├®e et coordonn├®e par le COREVIH, du 15 mai au 15 juin 2021. Cette action, cofinanc├®e avec lŌĆÖARS, a permis :
- la mise en place dŌĆÖune campagne de communication 360 de promotion du d├®pistage VIH/IST ;
- lŌĆÖenvoi de kits dŌĆÖautotests VIH au grand public (dont 1 500 fournis par la R├®gion) ;
- la coordination dŌĆÖactions de d├®pistage hors les murs ;
- lŌĆÖorganisation dŌĆÖun webinaire ;
- une formation courte validante en sant├® sexuelle ├Ā destination des professionnels de sant├®.
Elle a impliqu├® de nombreux partenaires (associations de lutte contre le VIH, CeGIDD/CPEF, Associations communautaires, Rectorat/├ētablissements scolaires, URPS....) et a touch├® de nombreux professionnels de sant├® et m├®dico-sociaux, des travailleurs sociaux et ├®ducatifs ainsi que le grand public. Plus de 5 000 m├®decins lib├®raux ont ainsi re├¦u un kit de communication Moi(s) sans tabou. Un article d├®di├® ├Ā la sant├® sexuelle et au r├┤le des m├®decins lib├®raux dans les parcours de sant├® renvoyant vers des outils pratiques a ├®t├® diffus├® dans le bulletin de lŌĆÖURPS ML. Les ├®quipes officinales ont re├¦u des ├®l├®ments dŌĆÖinformation et des outils pratiques. 268 professionnels ont suivi le webinaire en live le 29 mai 2021, 198 se sont inscrits ├Ā la formation sant├® sexuelle propos├®e en partenariat avec la Facult├® de M├®decine. Relay├®e largement sur les r├®seaux sociaux par les partenaires du COREVIH, la campagne de communication a permis de toucher un public large tout ├óge, orientation et genre confondus.
De septembre 2020 ├Ā juin 2021, lŌĆÖassociation Solidarit├® Sida, soutenue par la R├®gion, a organis├® aupr├©s de 15 lyc├®es, lŌĆÖaction intitul├®e ┬½ les apr├©s-midis du zapping ┬╗ repr├®sentant un total de 1 028 ├®l├©ves. Compte-tenu de la crise sanitaire, cette action habituellement organis├®e dans des salles de spectacles, a ├®t├® conduite au sein des ├®tablissements scolaires sous la forme dŌĆÖune exposition intitul├®e ┬½ Love Sex & Safe, lŌĆÖexposition de pr├®vention ┬╗. Men├®e de mani├©re ludique et p├®dagogique, cette d├®marche de pr├®vention en sant├® sexuelle globale vise ├Ā :
- augmenter le niveau de connaissance des lyc├®ens et apprentis sur la sant├® sexuelle (grossesses non d├®sir├®es, IST/VIH, violences sexuelles, cybersexualit├® et les moyens de protections) ;
- cr├®er un espace de parole positif et bienveillant sur les sexualit├®s ;
- rendre les ├®l├©ves acteurs de leur propre pr├®vention en favorisant lŌĆÖautonomie ;
- permettre aux jeunes de diffuser de lŌĆÖinformation ├Ā leur entourage ;
- diffuser du mat├®riel de pr├®vention et permettre lŌĆÖidentification des structures ressources pr├©s de chez eux.
Sous r├®serve dŌĆÖun ├®tat des lieux des besoins, de la mobilisation des acteurs et du vote des ├®lus, le plan r├®gional de lutte contre le sida devrait ├¬tre reconduit et sŌĆÖ├®tendre en 2022 ├Ā dŌĆÖautres lyc├®es publics, aux lyc├®es agricoles ainsi quŌĆÖaux CFA.
En savoir +
La R├®gion mobilis├®e contre le Sida
Aussi sur PF2S
D├®partement du Nord : une prise en charge compl├©te propos├®e...
R├ēGION
Les 1000 premiers jours
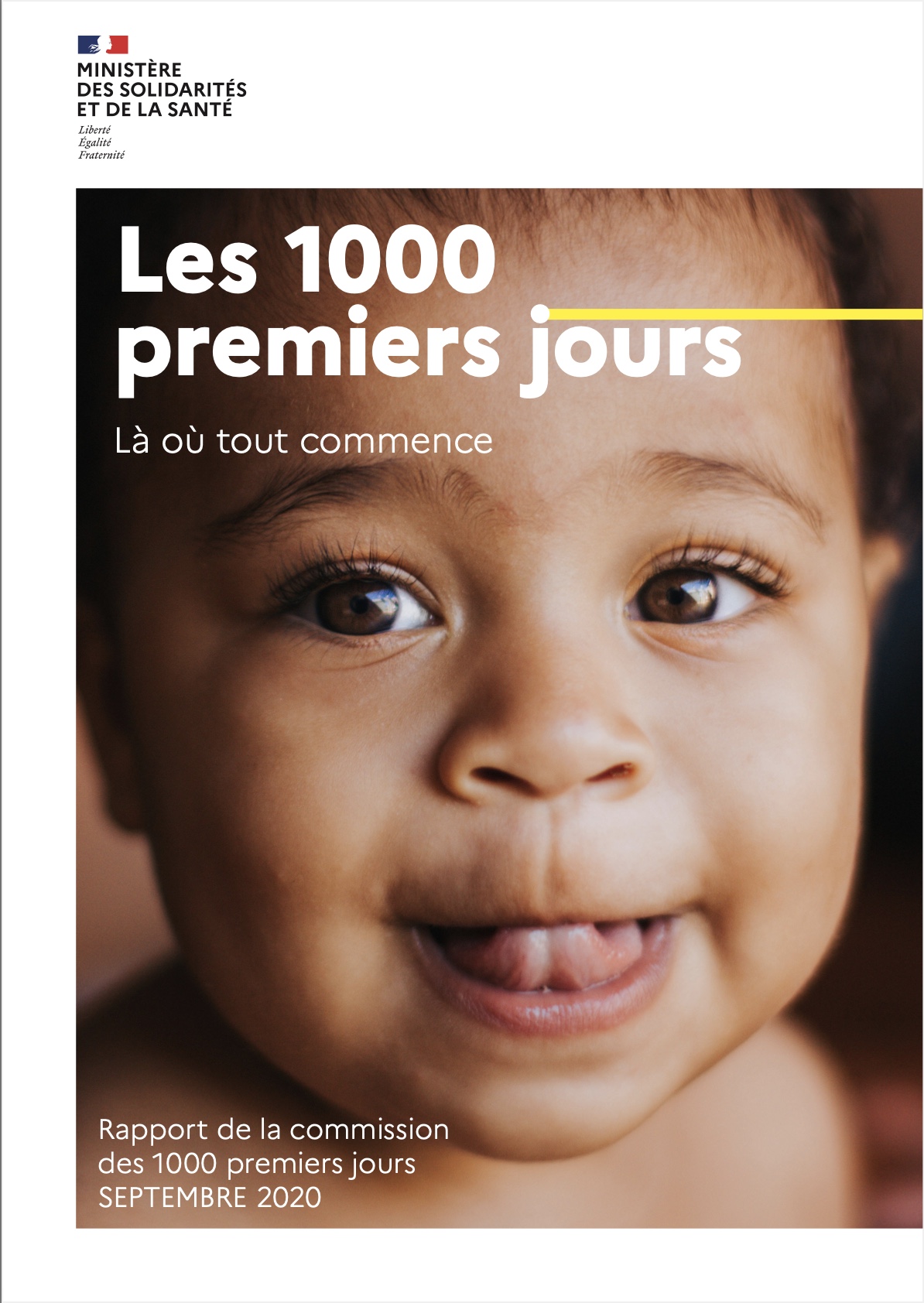 ├Ć lŌĆÖinitiative de lŌĆÖARS et de la Dreets Hauts-de-France, un appel ├Ā projet r├®gional sur les 1000 premiers jours, suite au rapport de la commission pr├®sid├®e par Boris Cyrulnik.
├Ć lŌĆÖinitiative de lŌĆÖARS et de la Dreets Hauts-de-France, un appel ├Ā projet r├®gional sur les 1000 premiers jours, suite au rapport de la commission pr├®sid├®e par Boris Cyrulnik.
En septembre 2020, la Commission des 1000 premiers jours pr├®sid├®e par la neuropsychiatre Boris Cyrulnik avait remis au secr├®taire d'├ētat Adrien Taquet son rapport (cf. ci-contre). La chantier national des 1000 qui sŌĆÖen est suivi sŌĆÖest d├®ploy├® sur cinq axes, soutenus par des appels ├Ā projets r├®gionaux autour :
- du rep├®rage des situations de fragilit├® et lŌĆÖaccompagnement des parents sans rupture tout au long des 1000 premiers jours ;
- du d├®veloppement dŌĆÖactions en promotion de la sant├® pour les plus petits (nutrition, environnement, expositions aux substances toxiques d├©s la p├®riode pr├®conceptionnelle dans le milieu professionnel, au domicile, dans les lieux dŌĆÖaccueil du jeune enfant, etc.) ;
- de la pr├®vention de lŌĆÖisolement et de lŌĆÖ├®puisement des parents, notamment des m├©res en post-partum ;
- de lŌĆÖam├®nagement des lieux et de lŌĆÖoffre pour favoriser lŌĆÖ├®veil culturel et artistique des tout-petits, notamment des plus d├®favoris├®s ;
- de la conciliation des temps entre vie professionnelle et parentalit├® ;
- de la place du p├©re ou du second parent.
Neuf projets ont ├®t├® retenus en Hauts-de-France, soit trois dans le Nord, deux dans lŌĆÖAisne et dans le Pas-de-Calais, un dans lŌĆÖOise et dans la Somme. Quatre th├®matiques ont ├®t├® cibl├®es : ├ēveiller aux arts, ├Ā la nature et aux go├╗ts (3 projets), Accueillir les enfants et leurs parents (3 projets), Proposer un accompagnement adapt├® aux situations sp├®cifiques (2) et Permettre aux parents de partager et souffler (1).
Une application mobile a ├®t├® cr├®├®e ainsi que le site internet 1000-premiers-jours.fr. Un livret des messages cl├®s de sant├® publique compl├©te la panoplie dŌĆÖoutils mis ├Ā disposition.
Les recommandations du rapport Cyrulnik
La commission sur les 1000 premiers jours a ├®mis de nombreuses recommandations, dont les principales sont :
ŌĆóŌĆēcr├®ation dŌĆÖun parcours des 1000 jours comprenant un accompagnement personnalis├® commen├¦ant d├©s lŌĆÖentretien du 4e mois, se poursuivant en maternit├® et jusquŌĆÖau domicile, et renforc├® en cas de fragilit├®s (handicaps, troubles psychiques ou fragilit├®s sociales)ŌĆē;
ŌĆó g├®n├®ralisation de lŌĆÖentretien pr├®natal pr├®coce, (ne touche que 28ŌĆē% des grossesses)ŌĆē;
ŌĆó augmentation des moyens des maternit├®s et des PMI, afin que chacune des cinq cents maternit├®s sur le territoire b├®n├®ficie dŌĆÖun lien ├®troit et quotidien avec la PMI pour mieux accompagner les parentsŌĆē;
ŌĆó allongement du cong├® paternit├®, premi├©re ├®tape dŌĆÖune r├®forme ambitieuse du cong├® parental, dans lŌĆÖint├®r├¬t du d├®veloppement de lŌĆÖenfant, mais ├®galement pour lutter contre la solitude et lŌĆÖisolement des mamansŌĆē;
ŌĆó g├®n├®ralisation et harmonisation du projet ├®ducatif de lŌĆÖaccueil des enfants avant 3 ans.
En savoir +
Rapport : Les 1000 premiers jours
Les 1000 premiers jours, l├Ā o├╣ tout commence.
Aussi sur PF2S
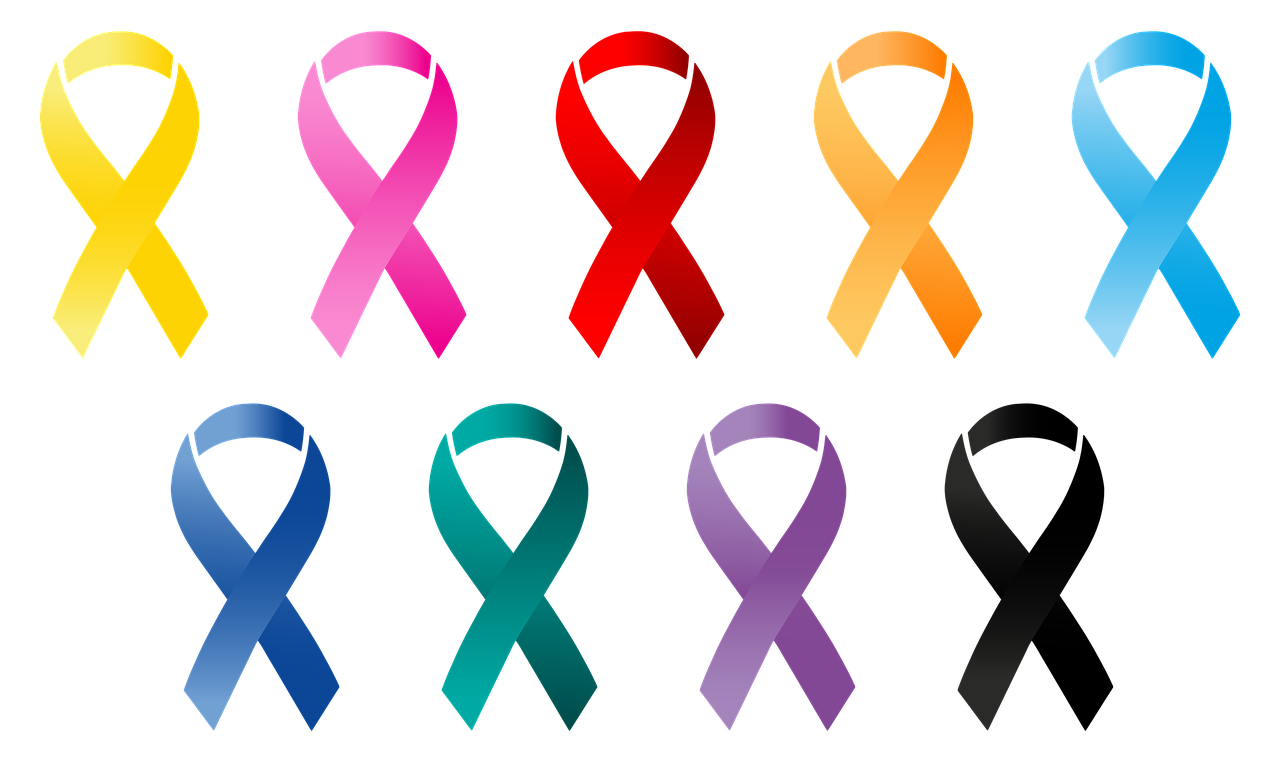
LŌĆÖorganisation autour des cancers mobilise en Hauts-de-France plusieurs organismes, dont les r├┤les sont compl├®mentaires.
 Oscar Lambret : centre r├®gional de lutte contre le cancer
Oscar Lambret : centre r├®gional de lutte contre le cancer
Le plus ancien dŌĆÖentre eux est le centre Oscar Lambret, fond├® en 1955, rappelle son directeur le Pr ├ēric Lartigau, ┬½ lŌĆÖun des dix-huit centres de lutte contre le cancer cr├®├® par ordonnance du g├®n├®ral de Gaulle du 1er octobre 1945, comme lŌĆÖinstitut Curie (Paris) ou lŌĆÖinstitut Gustave Roussy (Villejuif)ŌĆē┬╗. ├ētablissements hospitalo-universitaires avec statut dŌĆÖ├®tablissements de soins de sant├® priv├® dŌĆÖint├®r├¬t collectif (Espic), les centres de lutte contre les cancers poursuivent ├Ā la fois des objectifs de soins, de recherche et dŌĆÖenseignement.
Lire l'entretien complet du Pr ├ēric Lartigau
R├®seau r├®gional de coordinatioon du d├®pistage des cancers 
De leur c├┤t├®, le r├®seau r├®gional de coordination du d├®pistage des cancers (CRCDC) et Onco Hauts-de-France, qui ne prennent pas en charge de patients, sont n├®s de la fusion des anciennes structures du Nord - Pas-de-Calais et de Picardie. Devan├¦ant le d├®cret du 23 mars 2018 sur la r├®gionalisation des structures de gestion du d├®pistage des cancers, le CRCDC a r├®uni d├©s le 1er janvier 2017 en une seule entit├® associative, les cinq centres de coordination d├®partementaux des deux anciennes r├®gions. Les missions du CRCDC sont multiples. Il a en charge lŌĆÖorganisation et le suivi des trois programmes de d├®pistage des cancers (sein, colo-rectal, col de lŌĆÖut├®rus). Il coordonne, participe ou contribue ├Ā la r├®alisation dŌĆÖ├®tudes cliniques ou ├®pid├®miologiques sur les cancers. ┬½ LŌĆÖint├®r├¬t du d├®pistage organis├®, assure le Dr Jean-Luc Dehaene, pr├®sident du CRCDC, a ├®t├® dŌĆÖhomog├®n├®iser les pratiques et dŌĆÖemmener tous les professionnels de sant├®, radiologues, manipulateurs, m├®decins traitants dans une proc├®dure de qualit├® ├®criteŌĆē┬╗ et de b├®n├®ficier dŌĆÖune seconde lecture des clich├®s, autre gage de qualit├®.
Lire l'entretien complet du Dr Jean-Luc Dehaene
 Onco Hauts-de-France
Onco Hauts-de-France
Le R├®seau r├®gional de canc├®rologie, d├®nomm├® aussi Onco Hauts-de-France, est n├® le 30 juin 2017 de la fusion des deux associations nordiste et picarde, a un r├┤le de coordination, dŌĆÖharmonisation et dŌĆÖam├®lioration de la qualit├® des pratiques. ┬½ŌĆēCŌĆÖest un espace dŌĆÖ├®change de pratiques professionnelles, indique le DrŌĆēVillers, son pr├®sident, et dŌĆÖinformation notamment sur lŌĆÖusage de protocoles et de r├®f├®rentiels communsŌĆē┬╗. Il d├®veloppe ainsi des actions de formation, dŌĆÖinformation et dŌĆÖ├®valuation dans une logique de coordination des acteurs du soin.
Lire l'entretien du Pr Arnauld Villers
Espaces ressources cancer (ERC)
Cr├®├®s par le premier plan cancer en 2008, les Espaces ressource cancer (ERC), ont ├®t├® restructur├®s apr├©s la fusion des r├®gions de 2016. avec une volont├® de d├®ployer progressivement le dispositif sur les territoires non pourvus iniyialement (ex-Picardie). Ils jouent un r├┤le dŌĆÖinformation et dŌĆÖorientation des malades et de leurs proches. Ils proposent en outre des consultations et prestations de soins de support en ville adapt├®s aux besoins des malades. On compte ├Ā ce jour 12 ERC, avec des lieux dŌĆÖactivit├® d├®localis├®s ( 6 espaces dans le Nord, 3 dans lŌĆÖOise, 2 dans le Pas-de-Calais, 1 dans lŌĆÖAisne ; en attendant lŌĆÖouverture dŌĆÖun espace ├Ā Amiens, les Samariens sont orient├®s vers ceux de Boulogne, Beauvais ou Saint-Quentin.
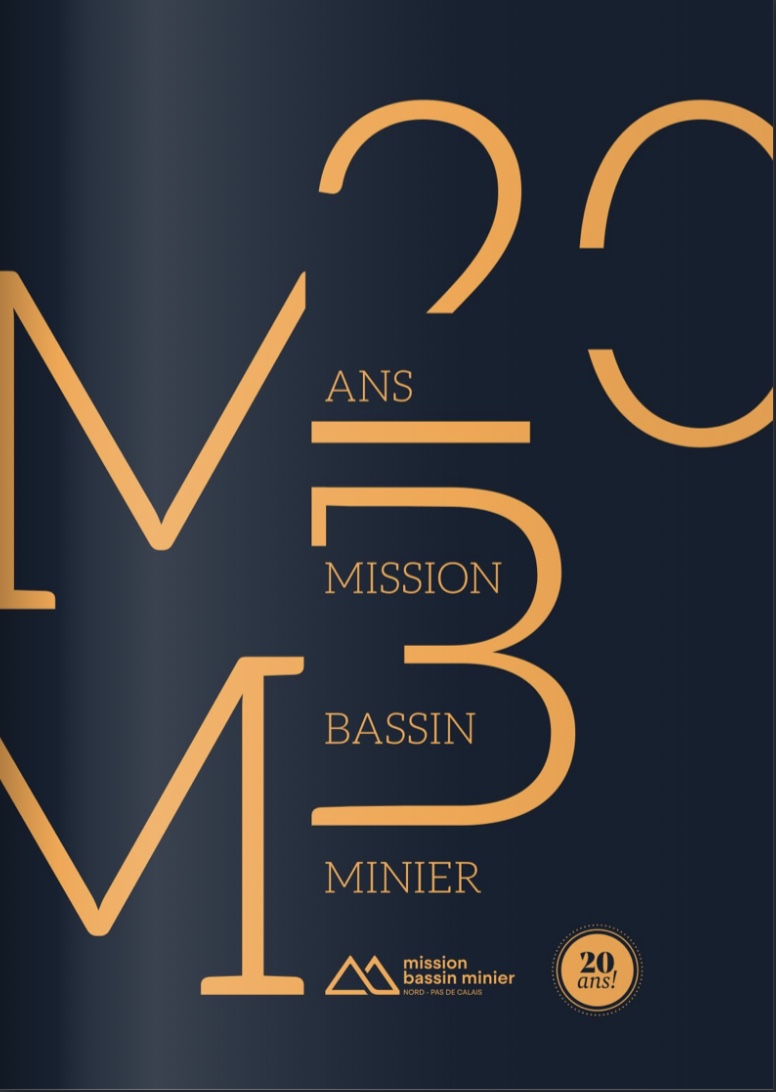 ├Ć mi-chemin entre les vingt ans de sa cr├®ation en 2020 et leur c├®l├®bration en 2022, la Mission Bassin minier vient dŌĆÖ├®diter un livre retra├¦ant la mutation du bassin et sa reconqu├¬te.
├Ć mi-chemin entre les vingt ans de sa cr├®ation en 2020 et leur c├®l├®bration en 2022, la Mission Bassin minier vient dŌĆÖ├®diter un livre retra├¦ant la mutation du bassin et sa reconqu├¬te.
Sant├® et coh├®sion sociale
Sant├® et coh├®sion sociale sont convoqu├®es dans ce livre c├®l├®bration au titre des d├®fis du bassin minier que la mission ├®ponyme souhaite relever dans les ann├®es ├Ā venir.
Ainsi en est-il de ce que les auteurs qualifient dŌĆÖ┬½ŌĆēanomalieŌĆē┬╗ de sant├®. Ils montrent ainsi que m├¬me si la situation de la sant├® des populations de bassin sŌĆÖest am├®lior├®e, la situation reste toujours pr├®occupante. Et de souligner avec quelque raison que lŌĆÖesp├®rance de vie actuelle est celle de la France dŌĆÖil y a trente ans malgr├® des progr├©s en mati├©re de d├®mographie m├®dicale. Mais lorsque les ressources disparaissent, elles le font de mani├©re plus rapide quŌĆÖailleurs dans les Hauts-de-France.
Paiuvtr├® et illectronisme : les obstacles au recours aux soins
Le d├®fi de la coh├®sion et de la solidarit├® r├®pond en miroir aux difficult├®s rencontr├®es : lŌĆÖexclusion sociale, reli├®e ├Ā la pauvret├®, est aliment├®e par lŌĆÖhistoire industrielle du bassin, un taux de ch├┤mage ├®lev├®, un faible taux dŌĆÖactivit├® des femmes, une hausse du nombre de familles mono-parentales ; ou encore par manque dŌĆÖun travail p├®renne et dŌĆÖun logement d├®cent. Auquel vient sŌĆÖajouter pour ces personnes d├®j├Ā tr├©s fragilis├®es un fort taux dŌĆÖillectronisme, que les auteurs analysent comme obstacle au recours aux soins et ├Ā la sant├®. Devenues ┬½ŌĆēinvisiblesŌĆē┬╗ des politiques publiques, elles ne peuvent ou ne savent acc├®der aux dispositifs mis en ┼ōuvre.
Vers une ing├®nierie sant├®
Tourn├®s vers lŌĆÖavenir, les auteurs voient dans le d├®veloppement de lŌĆÖing├®nierie ┬½ŌĆēsant├® ┬╗ une solution de nouveaux modes d'organisation tant pour le soin que pour la pr├®vention. ├ēvoquant les contrats locaux de sant├®, les conseils locaux de sant├® mentale et autres projets locaux de sant├®, il reste cependant, ├®crivent-ils, ┬½ ├Ā ├®tablir les bilans de leurs impacts, ├Ā en d├®battre et ├Ā en assurer la diffusion. ┬╗
Compl├®mentaire au livre, un film a ├®t├® r├®alis├® ├Ā partir dŌĆÖarchives, dŌĆÖinterviews dŌĆÖacteurs cl├®s sur le territoire et de grands t├®moins de lŌĆÖHistoire du Bassin minier. Il livre une page dŌĆÖhistoire du territoire dans lequel la Mission Bassin Minier occupe une place particuli├©re dans un paysage institutionnel et technique qui nŌĆÖa eu de cesse dŌĆÖ├®voluer.
En savoir +
La Mission Bassin Minier : 20 ans
Aussi sur PF2S
Lutte contre la pauvret├®ŌĆē- rapport r├®gional
Bassin minier : territoire d├®monstrateur de la lutte contre la pauvret├®
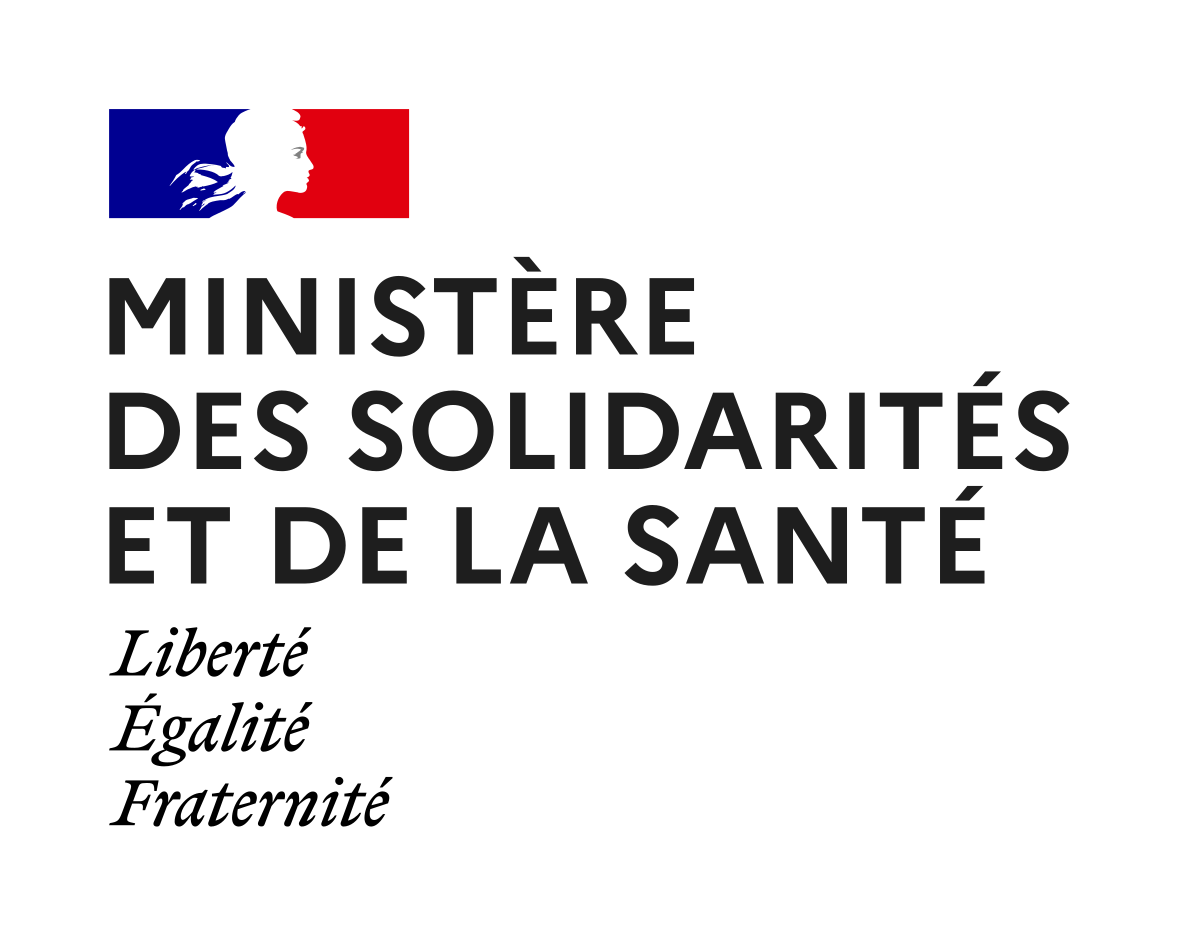 Le S├®gur de la sant├® a offert lŌĆÖoccasion dŌĆÖinscrire le mod├©le de la ┬½ sant├® participative ┬╗ dans le syst├©me de soins via les centres et maisons de sant├®.
Le S├®gur de la sant├® a offert lŌĆÖoccasion dŌĆÖinscrire le mod├©le de la ┬½ sant├® participative ┬╗ dans le syst├©me de soins via les centres et maisons de sant├®.
Les centres et maisons de sant├® ┬½ participatifs ┬╗ sŌĆÖadressent en priorit├® aux territoires d├®favoris├®s, dont une partie de la population pr├®sente un ├®tat de sant├® plus d├®grad├® du fait de leur pr├®carit├®, de leurs difficult├®s ├Ā acc├®der ├Ā lŌĆÖoffre de pr├®vention et de soins et aux droits sociaux. Les habitants des quartiers prioritaires rencontrent fr├®quemment des probl├®matiques de sant├® li├®es ├Ā la pr├®carit├® : surpoids des enfants, affections bucco-dentaires non prises en charge et pr├®gnance des souffrances psycho-sociales, renoncement aux soins et moindre recours aux d├®pistages (Observatoire national de la politique de la ville).
Le mod├©le de la ┬½ sant├® participative ┬╗ apporte une r├®ponse par un accompagnement m├®dical, psychologique et social. Il a fait la preuve de son efficacit├® aux ├ētats-Unis, Canada et au Br├®sil.
En allant-vers les usagers, en mettant en place des espaces de paroles, des actions de m├®diation en sant├®, avec des services dŌĆÖinterpr├®tariat professionnel, les centres et maisons de sant├® ┬½ participatifs ┬╗ prennent en compte lŌĆÖensemble des probl├®matiques des personnes tout en les rendant actrices de leur propre sant├®.
La phase exp├®rimentale durera deux ans pour 20 structures.
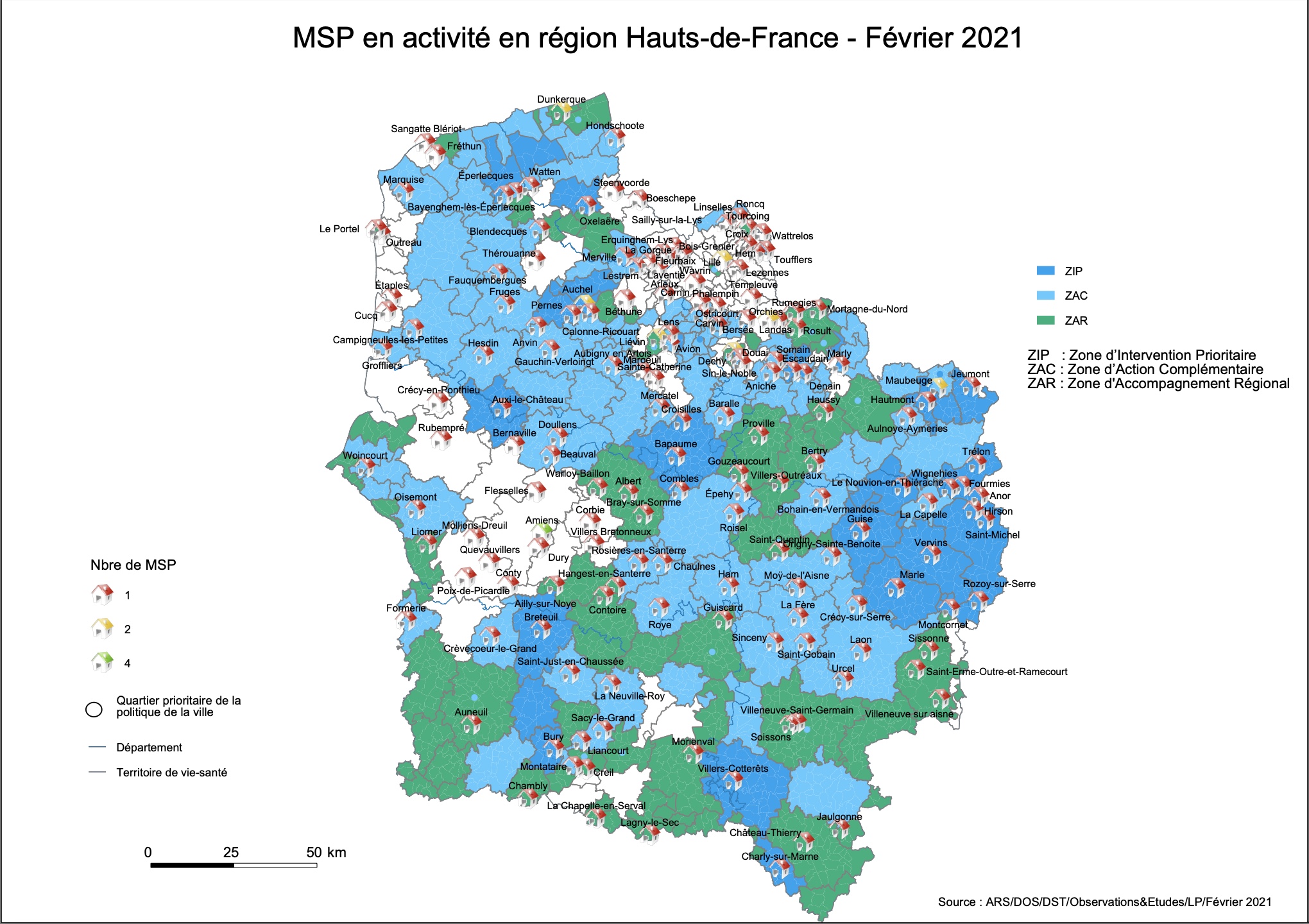
En savoir +
Appel ├Ā projets maisons de sant├® participatives

27-05-2025 | Actualit├®s
En partenariat avec la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France, le groupe de travail sant├® & social de G├®o2France vous invite...
Lire la suite05-11-2024 | Social
EUROPE Le fonds social europ├®en Cr├®e en 1957, le fonds social europ├®en avait pour but initial dŌĆÖaider ├Ā la...
Lire la suite05-11-2024 | Sant├®
NATIONAL Faire Alliance pour am├®liorer la sant├® des plus jeunes Dans le cadre de lŌĆÖexp├®rimentation Faire Alliance pour am├®liorer...
Lire la suite05-11-2024 | Sant├®
FOCUS Promouvoir l'activit├® physique et sportive Corpulence, activit├® physique et s├®dentarit├® en Hauts-de-France : les enseignements des Barom├©tres Sant├® Les...
Lire la suite05-11-2024 | Sant├®
FOCUS Promouvoir l'activit├® physique et sportive Journ├®e de la Plateforme ┬½ Sport et sant├® : promouvoir l'activit├® physique pour tous...
Lire la suite
Plateforme sanitaire et sociale | Derni├©res publications
Num├®ro 26 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France octobre 2025 Au sommaire de ce num├®ro R├ēGION 2 Webinaire sur la fragilit├®...
Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Derni├©res publications
Num├®ro 25 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France ao├╗t 2025 Au sommaire de ce num├®ro R├ēGION 2 Au travail en bonne...
Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Derni├©res publications
La synth├©se de la journ├®e annuelle de la PF2S 2024 Sport & sant├® Promouvoir l'activit├® physique pour tous et...
Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Derni├©res publications
Num├®ro 24 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France d'octobre 2024 Au sommaire de ce num├®ro R├ēGION 2 Cartographie des services num├®riques r├®gionaux...
Lire la suitePlateforme sanitaire et sociale | Derni├©res publications
Num├®ro 23 de la Plateforme sanitaire et sociale Hauts-de-France de juillet 2024 Au sommaire de ce num├®ro R├ēGION 2 Forte progression de la...
Lire la suite





















